Sainte Rose de Lima
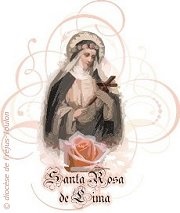
Rose fut la première sainte, canonisée, de l’Amérique Latine. Elle était une sainte de couleur, comme on disait, car son père était un colon espagnol et sa mère, une métisse. Rose naît à Lima en 1586 et y meurt seulement à l’âge de 33 ans, en 1617.
Elle n’eut jamais d’autres horizons que ceux de sa famille et de sa ville natale, mais par son cœur donné au Christ Sauveur, sa prière et son offrande étaient vraiment universelles. Rose était une fillette extrêmement douée pour les arts. Très tôt, elle doit travailler pour aider ses parents, ruinés.
Elle est admise en 1606 dans ce qu’on appelait le Tiers-Ordre de saint Dominique, prenant comme modèle sainte Catherine de Sienne. Comme elle, Rose continue à vivre dans le monde, gardant les pieds sur terre, consacrée au travail quotidien et au service des pauvres. Elle s’inflige de rudes mortifications, favorisée de grâces mystiques : des apparitions du Christ, de la Vierge Marie et de son ange gardien.
Rose de Lima n’est pas pour autant excentrique ou illuminée. Demeurant dans sa famille, elle est une laïque consacrée au Règne de Dieu, engagée dans les travaux quotidiens et le service des malades, nullement repliée sur elle-même et vivant au septième ciel, comme on décrit parfois les Mystiques.
Une preuve de son réalisme spirituel, c’est par exemple la manière dont elle secouait ses frères dominicains, les trouvant trop intellectuels et pas assez brûlants d’une « vive flamme d’amour envers Dieu ». Elle avait aussi une grande compassion et une vive solidarité envers les Indiens.
Prenant part au souci missionnaire de l’Église, Rose portait l’angoisse de leur salut spirituel et de leur libération humaine. Pour eux, elle avait offert sa vie et sa mort prématurée ne lui permit pas de réaliser son grand rêve : adopter un jeune Indien.
D’après Frère Bernard Pineau, OP


