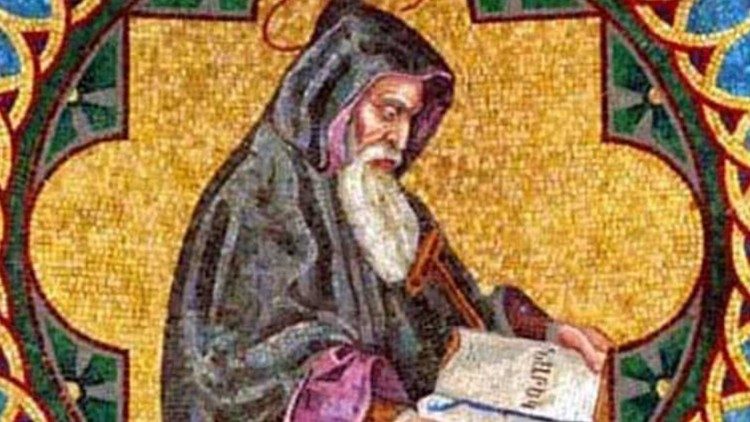Saint Jean Baptiste de La Salle,
Fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes
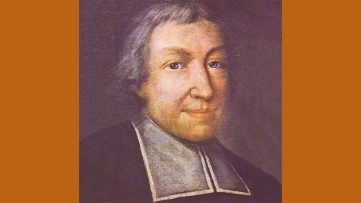
Les enseignants de tous les temps et de tous les lieux ne pouvaient pas avoir de meilleur saint patron ; à le déclarer comme leur point de référence fut le pape Pie XII seulement 50 ans après sa canonisation.
Jean-Baptiste a peut-être trouvé l’inspiration dans la famille : aîné de 10 enfants, resté orphelin des deux parents à 21 ans, malgré ses études au séminaire, en fait, il doit s’occuper de ses frères. Cela ne l’empêche pas de faire ses vœux et d’obtenir un doctorat en théologie avec brio.
L’Enseignement comme vocation
Nommé par l’archevêque de Reims, Jean commence à s’occuper de l’éducation des jeunes; il rencontre ainsi Adriano Nyel, un laïc qui a consacré sa vie à l’école populaire. Mais Jean se rend vite compte que quelque chose ne va pas : les enseignants sont mal préparés et sans stimulations. Il comprend que c’est là que l’on doit agir : l’enseignement doit être une mission, et les élèves méritent des enseignants instruits.
Puis il cherche, étudie, observe les méthodes des meilleures écoles, loue une maison et s’y installe avec ces enseignants, les instruisant lui-même. Il leur enseigne que les leçons ne doivent plus être individuelles, mais collectives, préférant l’organisation des écoles dans les salles de classe; il donne la priorité à la langue maternelle – la Français – au lieu du latin dans l’apprentissage de la lecture, il prête également attention aux besoins moraux et non seulement culturels des enseignants.
La mission des « frères » plus âgés
Les enseignants qui affluent vers Jean-Baptiste ne sont pas prêtres, même s’il mûrit l’idée qu’ils devraient consacrer leur vie entièrement à leurs élèves, renonçant à se marier et avoir une famille. Alors il les habille d’une robe noire avec dossard blanc, manteau paysan et sabots et leur propose une première règle de vie qu’il commence à écrire en 1685.
Près de dix ans plus tard, il est élu supérieur des Frères des Écoles Chrétiennes, la congrégation qu’il a fondée à la suite de cette première expérience, la première entièrement formée par des enseignants masculins qui restent laïcs, parce qu’il veut qu’ils puissent enseigner non seulement dans la foi, mais dans la connaissance et les professions.
Avec eux, il atteint d’importants objectifs pédagogiques : il donne de l’importance à la méthode simultanée de l’enseignement primaire qui sera gratuit dans les écoles qu’il a fondées ; il organise des écoles du soir et du dimanche pour les jeunes travailleurs et invente l’ancêtre de l’enseignement moderne technique, commercial et professionnel.
La débâcle de l’ignorance… et des ignorants
Au fur et à mesure que la congrégation croît, croît également la critique qu’elle s’attire sur elle-même. Le fondateur est d’abord attaqué par le haut clergé de Paris, par certains curés, par l’autorité civile, à tel point de le contraindre à tout transférer au village de Saint-Yon, près de Rouen.
A bout, Jean-Baptiste réagit en se retirant dans la prière, l’isolement pénitentiel, la méditation et l’étude. Il sera accusé par les soi-disant « enseignants de rue » d’être payé par ses élèves, de jouir de privilèges réservés aux corporations professionnelles, de maintenir une communauté d’enseignants sans autorisation. Infamie gratuite et sans motif.
Sans plus, en 1702, après une visite canonique, il est déchu du poste de supérieur. « Si notre institut est l’œuvre de l’homme, il ne peut manquer de tomber ; mais si c’est l’œuvre de Dieu, tous les efforts pour le détruire résulteront vains », est sa réaction.
À sa mort en 1719, il y avait déjà 23 maisons et dix mille élèves. Trente mille personnes affluèrent à ses funérailles, dans la petite ville où il s’était réfugié. Ses restes furent transportés à Rome dans la maison générale de l’institut en 1937.
Copyright © Libreria Editrice Vaticana