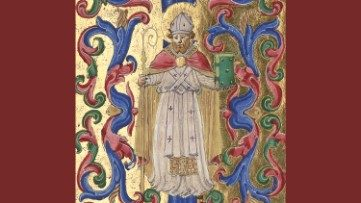La vertu éprouvée produit l’espérance

Saint Paul est très réaliste. Il sait que la vie est faite de joies et de peines, que l’amour est mis à l’épreuve lorsqu’augmentent les difficultés et que l’espérance semble disparaître devant la souffrance.
Pourtant, il écrit : « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance » (Rm 5, 3-4).
Pour l’apôtre, la tribulation et la souffrance sont les conditions typiques de ceux qui annoncent l’Évangile dans des contextes d’incompréhension et de persécution (cf. 2 Co 6, 3-10).
On perçoit dans ces situations une lumière dans l’obscurité. On découvre comment l’évangélisation est soutenue par la force qui découle de la croix et de la résurrection du Christ. Cela conduit à développer une vertu étroitement liée à l’espérance : la patience. Dans un monde où la précipitation est devenue une constante, nous nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite.
On n’a plus le temps de se rencontrer et souvent, même dans les familles, il devient difficile de se retrouver et de se parler calmement. La patience est mise à mal par la précipitation, causant de graves préjudices aux personnes. En effet, l’intolérance, la nervosité, parfois la violence gratuite surgissent, provoquant l’insatisfaction et la fermeture.
De plus, à l’ère d’ internet où l’espace et le temps sont dominés par le “ici et maintenant”, la patience n’est pas la bienvenue. Si nous étions encore capables de regarder la création avec émerveillement, nous pourrions comprendre à quel point la patience est décisive.
Attendre l’alternance des saisons avec leurs fruits ; observer la vie des animaux et les cycles de leur développement ; avoir le regard simple de saint François qui, dans son Cantique des créatures composé il y a exactement 800 ans, percevait la création comme une grande famille et appelait le soleil “frère” et la lune “sœur”. ‘Cf. Sources Franciscaines, n. 263, 6.10.)
Redécouvrir la patience fait beaucoup de bien à soi-même et aux autres. Saint Paul recourt souvent à la patience pour souligner l’importance de la persévérance et de la confiance en ce que Dieu nous a promis, mais il témoigne avant tout que Dieu est patient avec nous, Lui qui est « le Dieu de la persévérance et du réconfort » ( Rm 15, 5).
La patience, qui est aussi le fruit de l’Esprit Saint, maintient vivante l’espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. Apprenons donc à souvent demander la grâce de la patience qui est fille de l’espérance et en même temps la soutient.
BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ – PAPE FRANÇOIS
L’espérance a Dieu pour source, centre et but
L’espérance est une vertu « théocentrée », une vertu qui a Dieu pour source, centre et but. C’est Lui que nous devons prier, c’est en Lui que nous devons espérer avant même de chercher des consolations ou des moyens humains.
Or, si la Vierge est capable de nous tourner vers la source divine de l’espérance, d’opérer en nous un recentrement spirituel et théologique, c’est parce qu’elle est passée, dans son existence terrestre, par le plus formidable trou d’air de l’histoire humaine : la mort du Fils qui soutenait, en tant que Parole de Dieu, le monde.
La Vierge a connu cet instant inouï où la source de la vie a été mise à mort. Et elle a continué à croire ! Il n’existera plus jamais dans l’histoire d’exemple plus remarquable d’héroïcité de la foi ! À ce titre, Marie est bien placée pour nous éduquer à surmonter les épreuves touchant l’obscurcissement de la foi.
L’esprit de reconnaissance.
I. La reconnaissance pour les grâces qu’on a reçues est un devoir essentiel de la piété. Or cette reconnaissance suppose nécessairement la connaissance des grâces et des miséricordes de Dieu ; et elle ne peut être vive et agissante qu’à proportion que le sentiment que l’on a des grâces et des miséricordes reçues, sera vif et agissant ; mais ce sentiment n’est jamais vif dans une âme qui n’a que peu de confiance en Dieu.
Elle n’ose se promettre de recevoir beaucoup pour l’avenir ; elle n’ose de même croire avoir beaucoup reçu par le passé. Comment avec cette disposition les sentiments de sa reconnaissance pourraient-ils être vifs et capables de faire sur son cœur de profondes impressions ?
II. Si on lui représente quelquefois la grandeur des miséricordes que Dieu lui a faites, et si on la contraint d’en convenir , sa reconnaissance n’en devient pas plus vive et plus agissante.
Son espérance toujours faible et tremblante ne lui permet presque pas de croire qu’elle en soit plus heureuse, ou plus favorisée de Dieu ; elle se sent portée à croire que toutes ces grandes grâces ne serviront qu’à la rendre plus malheureuse, et à attirer sur elle une plus rigoureuse condamnation : et ces réflexions anéantissent presque en elle le sentiment des miséricordes de Dieu et l’esprit de reconnaissance; ce qui devient pour elle un nouvel obstacle à l’esprit de prière , et aux nouvelles grâces que Dieu lui aurait faites .
« Car l’ingratitude, dit S. Bernard, est un vent brûlant qui dessèche la source des grâces et les empêche de couler sur nous. »
P. Gaud
Prière du Jubilé
Père céleste,
En ton fils Jésus-Christ, notre frère,
Tu nous as donné la foi,
Et tu as répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint, la flamme de la charité
Qu’elles réveillent en nous la bienheureuse espérance de l’avènement de ton Royaume.
Que ta grâce nous transforme,
Pour que nous puissions faire fructifier les semences de l’Evangile,
Qui feront grandir l’humanité et la création tout entière,
Dans l’attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle,
Lorsque les puissances du mal seront vaincues,
Et ta gloire manifestée pour toujours.
Que la grâce du Jubilé,
Qui fait de nous des Pèlerins d’Espérance,
Ravive en nous l’aspiration aux biens célestes
Et répande sur le monde entier la joie et la paix
De notre Rédempteur.
A toi, Dieu béni dans l’éternité,
La louange et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen !
Prières de la messe du jour
Dieu, par ton nom sauve-moi, rends-moi justice par ta puissance; Dieu, entends ma prière, écoute les mots que je dis. (Ps 53, 3-4)
Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin; donne-nous d’accueillir avec joie notre relèvement et d’en témoigner par la fidélité de notre vie. Par le Christ Notre-Seigneur.
Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur tout-puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu’à la source dont ils descendent.
Elle est inépuisable, la grâce de Dieu: par son sang, le Christ nous obtient la rédemption, le pardon de nos fautes. (Ep 1, 7)
Nous t’en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau : fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté.
Tourne ton regard, Seigneur, vers ceus qui te servent, et se confient en ta miséricorde, dans ta bienveillance, accorde_leur la protection de ton secours. Par le Christ notre Seigneur.